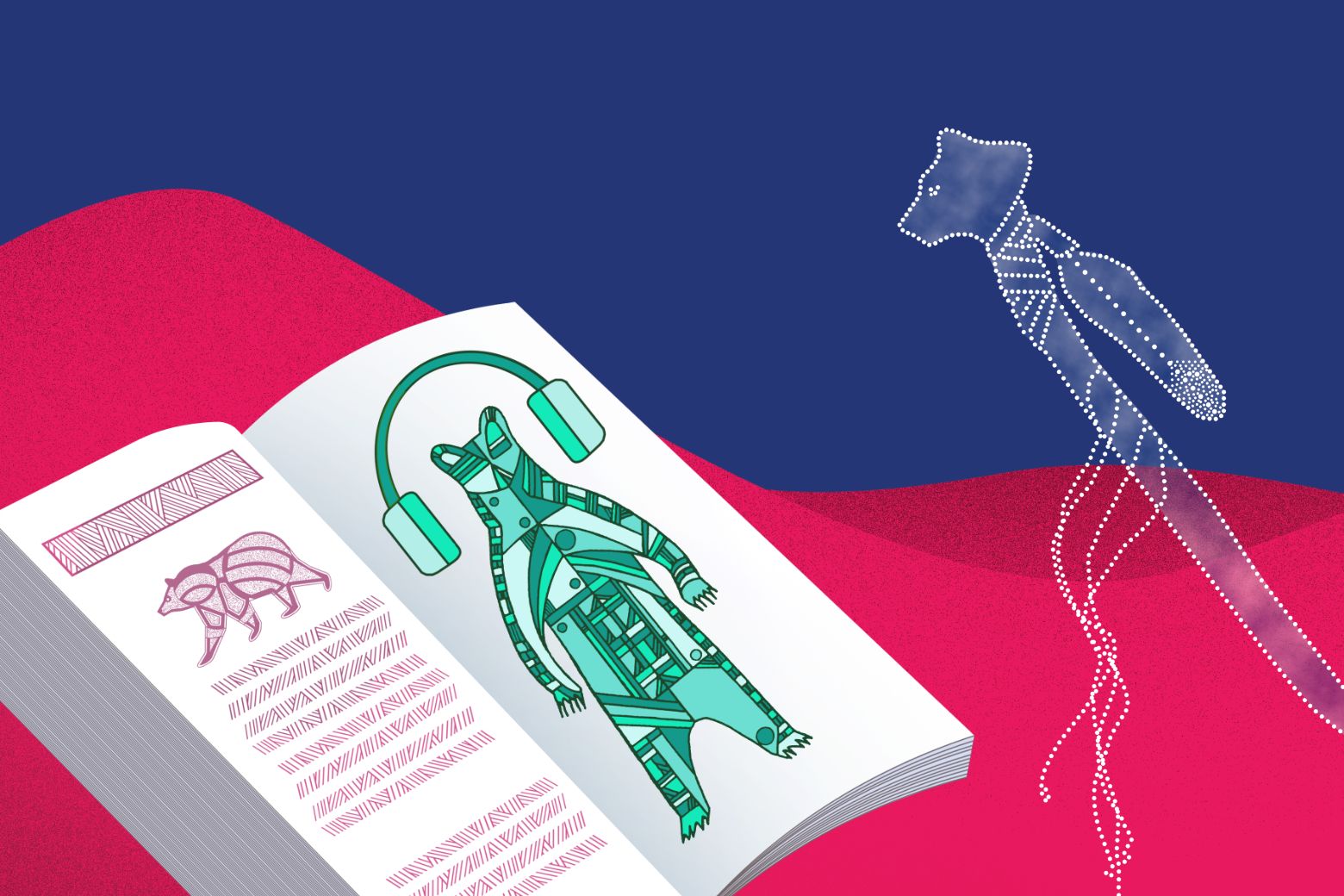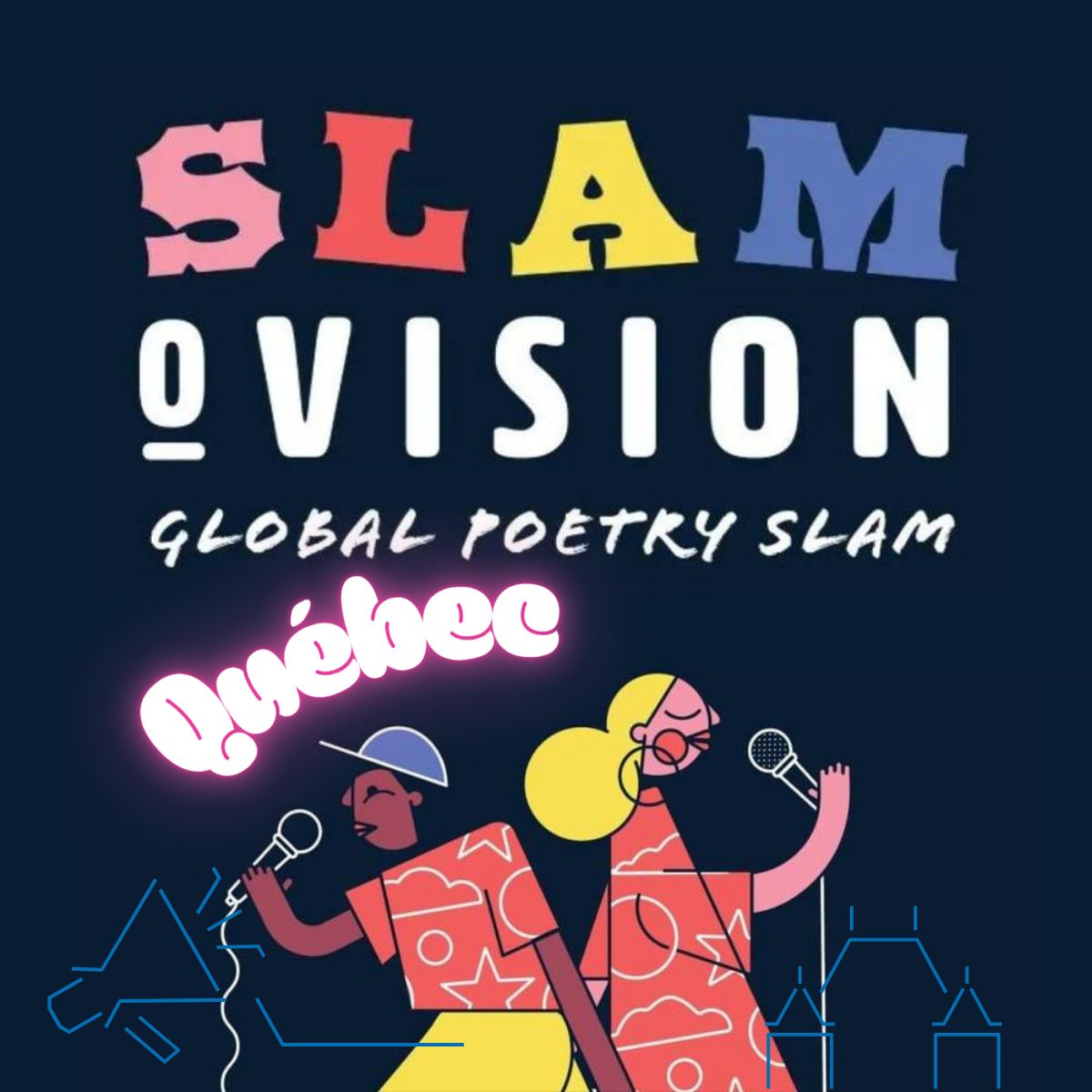(Re)cartographier les littératures autochtones: Au-delà des langues, des territoires, des pratiques et des genres
Inspiré du concept de (re)cartographie développé par la chercheuse seneca Mishuana Goeman, le colloque (Re)cartographier les littératures autochtones: Au-delà des langues, des territoires, des pratiques et des genres propose un espace de discussion sur la manière dont les littératures des Premiers Peuples remettent en question les délimitations géographiques et symboliques. Les présentations porteront à la fois sur la représentation de l’espace dans les œuvres littéraires et sur des enjeux institutionnels, formels et linguistiques qui encadrent la production, l’enseignement et la circulation des littératures autochtones.
Programme
9h15 – « S’rakoonti li z’istwayrs daan l’taand kaayaash » : Formes et frontières dans la littérature di Michif d’la rivyayr roozh, conférence d’ouverture de Matthew Tétreault, animée par Shayne Michael
Cette conférence propose de réfléchir aux tensions formelles et linguistiques au cœur de l’histoire littéraire, notamment francophone, des Michifs de la rivière Rouge. Matthew Tétreault se penchera sur quelques poèmes de George Morrissette et sur le projet de résistance discursive de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba au début du 20e siècle afin de montrer comment la porosité culturelle façonne cette littérature nationale et en informe les tensions, ainsi que les accords «des purs Métchifs».
10h15 – Cartographies institutionnelles et résistances créatrices, avec Eang-Nay Theam, Isabella Huberman, Pénélope Cormier et Shayne Michael, animé par Ana Kancepolsky Teichmann
Ce panel interroge les effets des frontières institutionnelles dans le développement et la diffusion des littératures autochtones. Eang-Nay Theam portera un regard critique sur l’histoire littéraire québécoise en analysant la place des littératures autochtones dans des ouvrages de référence dédiés à l’enseignement collégial. Pénélope Cormier et Shayne Michael aborderont l’expérience des artistes wolastoqey face au cloisonnement institutionnel produit par la fragmentation linguistique et géographique, tout en soulignant la portée transformatrice de leurs démarches artistiques. Isabella Huberman examinera l’écriture de Margaret Sam-Cromarty pour proposer une re-localisation de son œuvre au sein du corpus des littératures autochtones du Québec.
11h45 – Espaces géographiques, poétiques et corporels, avec Franck Miroux, Ma?gorzata Soko?owicz et Gabrielle Demers, animé par Isabella Huberman
Ce panel aborde l’œuvre de trois auteurs et autrices autochtones. Franck Miroux montrera comment Richard Wagamese retravaille la cartographie des espaces ontariens dans son roman Indian Horse. Ma?gorzata Soko?owicz analysera la construction de l’espace dans la poésie d’Éléonore Sioui pour souligner sa portée décolonisatrice. Gabrielle Demers explorera l’œuvre de Billy-Ray Belcourt à travers le concept du body-territory qui permet une (re)cartographie du corps et de l’espace.
14h – Perspectives pluridisciplinaires sur les littératures autochtones, avec Charlie Wenger, Véronique Basile Hébert et Isabelle St-Amand, animé par Alec Mahoney
Les communications de ce panel abordent les liens entre espace et littérature. Charlie Wenger proposera une interprétation de l’habiter inuit à partir d’œuvres littéraires et cinématographiques. Véronique Basile Hébert et Isabelle St-Amand se pencheront, quant à elles, sur la présentation du spectacle Sikahotew dans la communauté atikamekw de Manawan tout en réfléchissant aux façons dont il remet en question les frontières du littéraire.
15h30 – Imaginaires autochtones en mouvement, avec Safoura Ajdari, Julie Fromont et Mélissa Thériault, animé par Isabelle St-Amand
Les discussions proposées dans ce panel assurent des rencontres au-delà des frontières linguistiques, nationales et temporelles. Safoura Ajdari étudiera la version en persan de Kukum de Michel Jean pour souligner la complexité des négociations culturelles entre deux mondes rapprochés par la traduction. Julie Fromont mettra en dialogue l’œuvre de l’écrivaine innue An Antane Kapesh et celle de l’écrivaine kanaké Déwé Gorodé à travers une lecture écopoétique. Dans la communication de Mélissa Thériault, le passé et le présent rencontreront le futur à travers une lecture des œuvres autochtones contemporaines qui explorent la dystopie, l’utopie et la science-fiction.
Colloque organisé par la Chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, dans le cadre de la 14e édition du Salon du livre des Premières Nations
Comité organisateur: Maude-Lanui Baillargeon, Marie-Eve Bradette, Ana Kancepolsky Teichmann, Alec Mahoney